

Analyse de la crise énergétique en République Démocratique du Congo et son impact sur le potentiel de croissance économique.
La République démocratique du Congo (RDC), riche en ressources naturelles et en potentiel énergétique, est confrontée à une crise électrique qui perdure depuis des décennies. Alors que le pays possède une capacité de production estimée à 100 000 mégawatts, seulement 21 % de sa population accède à l’électricité. Cela signifie que près de 80 millions de Congolais vivent sans électricité, représentant une part importante des 13 % de la population africaine privée de courant.
Le déficit énergétique de 2 500 MW entrave le développement économique du pays. Chaque mégawatt non produit se traduit par une perte de 20 millions de dollars, selon le ministère de l’Énergie. Si ce déficit était comblé, le PIB national, actuellement évalué à 70 milliards de dollars, pourrait potentiellement doubler. Étonnamment, la RDC continue d’importer de l’électricité, notamment pour ses industries minières, alors qu’elle abrite le site d’Inga, capable de générer à lui seul 40 000 MW.
Les raisons de cette impasse sont multiples et complexes. Depuis 1989, la construction de nouveaux barrages publics a été quasi inexistante, tandis que la population a triplé. La libéralisation du secteur en 2014 n’a permis l’ajout que de 500 MW, et l’absence d’un cadre incitatif a freiné les investissements. L’Agence nationale pour l’électrification des zones rurales (ANSER), lancée en 2020 avec un objectif ambitieux de 744 MW, n’a délivré que 38 MW en cinq ans, témoignant d’un manque de stratégie efficace.
Les conséquences de cette crise sont palpables. Les ménages dépensent environ 4 milliards de dollars par an en charbon de bois, représentant 67 % de leur facture énergétique. Cette dépendance au bois de chauffage contribue à la déforestation rapide dans le bassin du Congo, un écosystème crucial pour la planète. Pendant ce temps, la Société nationale d’électricité (SNEL) peine à générer seulement 1,2 milliard de dollars de revenus.
À Kinshasa, l’absence d’électricité structure une économie de survie. Les salles d’accouchement fonctionnent à la lumière des lampes torches, les usines tournent à une fraction de leur capacité, et les étudiants étudient à la lueur des bougies. Ce tableau est d’autant plus frustrant pour un pays qui dispose de ressources hydrauliques, solaires et éoliennes considérables.
L’accent mis sur le projet du Grand Inga, souvent retardé et dépendant de financements extérieurs, a souvent éclipsé les solutions locales. Pourtant, l’Atlas national des énergies renouvelables recense plus de 700 sites adaptés aux microcentrales hydroélectriques, qui pourraient offrir des alternatives viables pour une électrification rapide. En réorientant même 10 % des fonds actuellement dépensés en charbon de bois, le pays pourrait développer un réseau de petites unités de production d’énergie.
L’urgence de la situation est à la fois économique, sociale et environnementale. Sans un véritable changement dans le secteur énergétique, la RDC pourrait ne pas atteindre l’Objectif de développement durable n°7, qui vise un accès universel à l’électricité d’ici 2050. Chaque avancée en matière d’électrification pourrait générer une croissance additionnelle de 0,3 % du PIB, selon la Banque africaine de développement. La lumière ne doit pas être perçue comme un luxe, mais comme une nécessité fondamentale pour construire une économie diversifiée et inclusive.
La RDC a le potentiel de transformer sa crise énergétique en une opportunité de développement. Il est temps d’agir pour libérer ce potentiel et apporter une lumière durable à tous les Congolais.












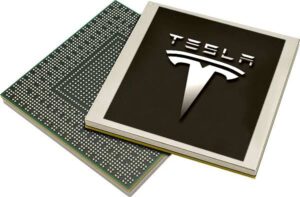


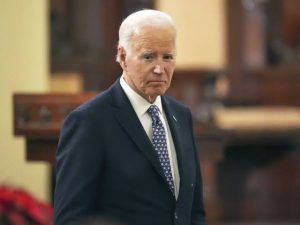

Laisser un commentaire